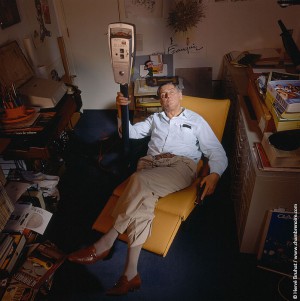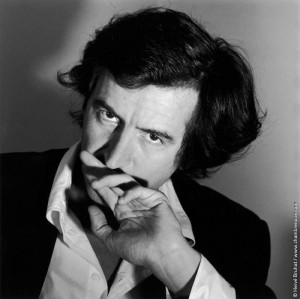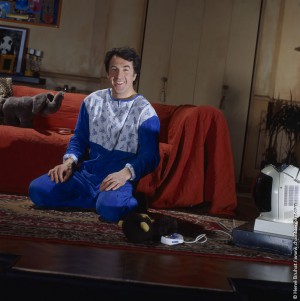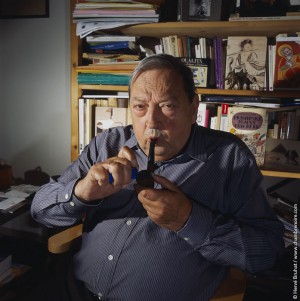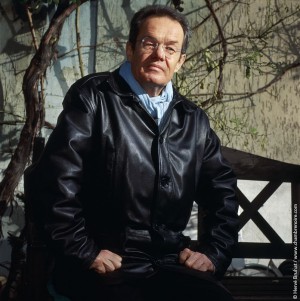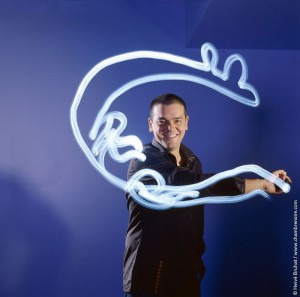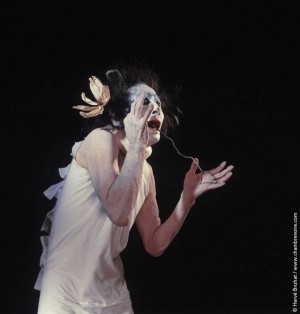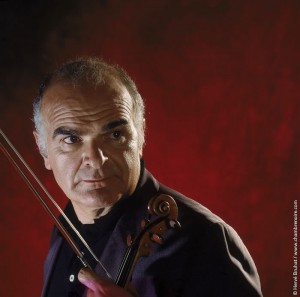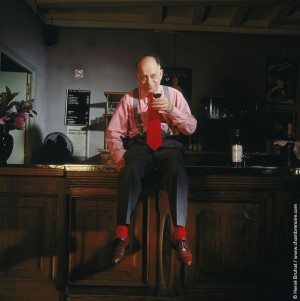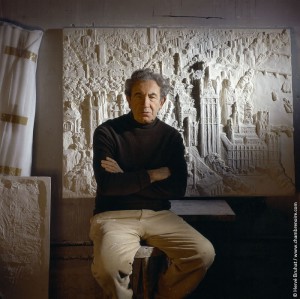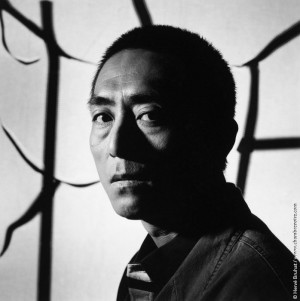Portraits
Actualités
Livre "À Rome la nuit" d'Hervé Gloaguen
Parution du nouveau livre d'Hervé Gloaguen "À Rome la nuit" aux éditions contrejour.
Exposition de Lily Franey à Dieppe
Du 10 au 28 mars "Les âges de la vie"
Exposition de Lily Franey à Dieppe.
Dans le cadre de "Mars au Féminin" et sa thématique 2025Livre : "Atlas mondial de l'artisanat d'art" par François Goudier
"Atlas mondial de l'artisanat d'art" publié chez Flammarion d'Isabelle Dupuy
Exposition de Lily Franey à Bagneux
Du 28 novembre 2024 au 9 janvier 2025
exposition de Lily Franey "Droit des enfants, droit au sport"
Grilles du parc Richelieu à Bagneux